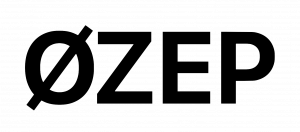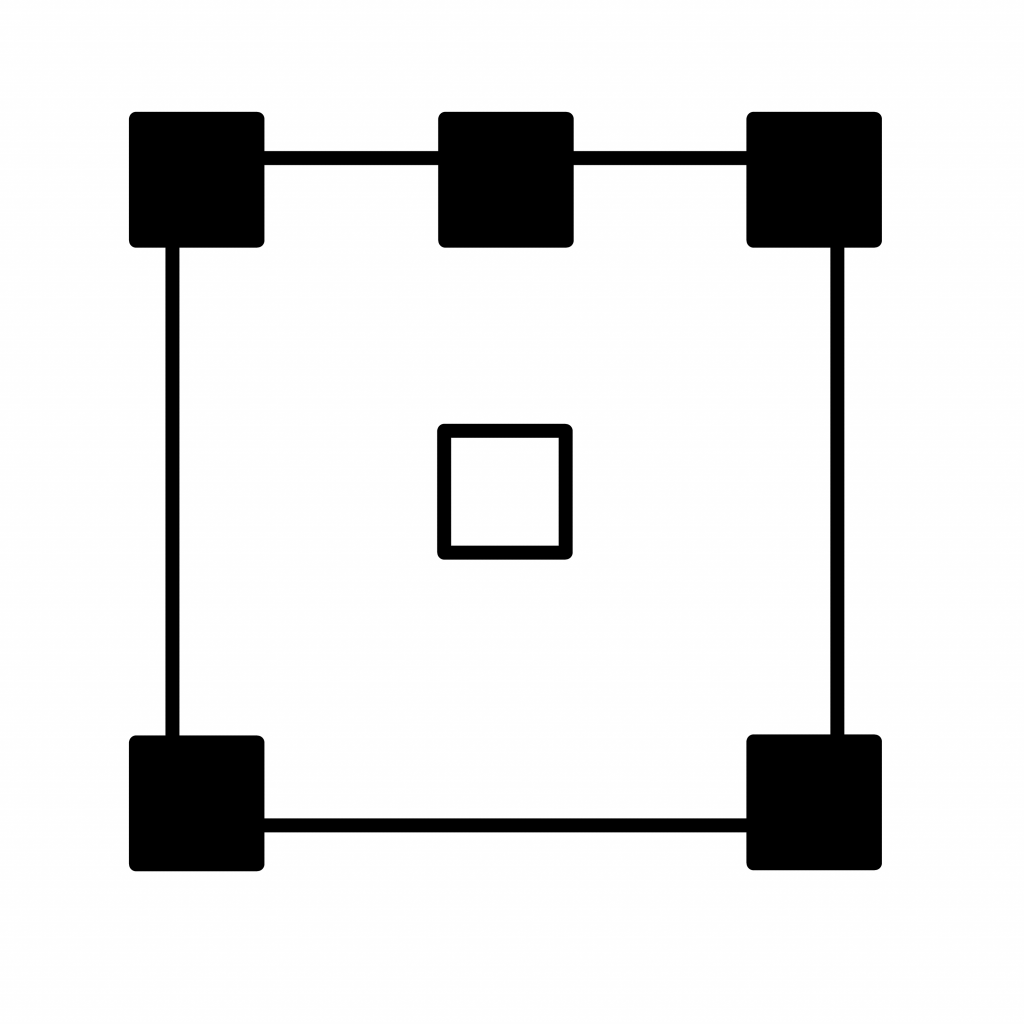◀︎ Précédent
Suivant ▶︎
Mixage Multicanal
Systèmes audio
Plans sonores
Atmosphères
Évolution du son
Effet de réalisme
Enceinte basse
C’est quoi un mixage multicanal ?
Comme son nom l’indique, c’est un mixage sonore qui distribue le son dans plusieurs canaux.
Oui, mais encore ?
Contrairement à un mixage stéréo, celui que l’on entend dans des écouteurs, des casques et qui ne comporte que deux canaux d’écoute, un à gauche et un à droite (2.0) ou sur des chaines hifi avec parfois une enceinte basse (2.1), le mixage multicanal propose une stéréophonie de 360° et permet, grâce aux enceintes surround, des choix créatifs plus élaborés et donc plus d’immersion dans l’écoute d’une œuvre.
On peut considérer qu’un mix est multicanal à partir d’un système 5.1, trois enceintes en façade, deux enceintes en surround et une enceinte basse. C’est la configuration de mixage minimum pour une diffusion cinéma.

Pourquoi autant d’enceinte ?
Évoluer dans un environnement en trois dimensions au milieu d’une multitude de sources sonore est le quotidien de toutes les espèces munies d’une ouïe sur notre planète. Alors, la meilleure manière de retranscrire cet environnement est de disperser autour d’un individu suffisamment d’enceintes et de répartir judicieusement les sons dans les bonnes sources.
1. Les systèmes audio :
Dans une salle de cinéma, on fait face à des images étalées sur un écran plat en deux dimensions. Pour créer une profondeur à ces images et retrouver une sensation de troisième dimension, on utilise des sons dispersés horizontalement dans un système sonore autour du spectateur. Dans le cas d’un système Atmos, on diffuse aussi des sons verticalement grâce aux enceintes du plafond.
On retrouve plusieurs sortes de système sonore dans les salles de cinéma : le 5.1, le 7.1 et le 7.1.4 (technologie Dolby Atmos) seulement 200 salles en France en sont équipées.
Schémas représentant la position des enceintes des différents systèmes en contexte cinéma ou home cinéma :

2.0

2.1

5.1

7.1

7.1.4 ATMOS
2. Mixage d’une scène sur un système 5.1, « Les plans sonores » :
Dans un système 5.1 on a à notre disposition 3 enceintes qui nous font face (gauche, centre, droite) et 2 enceintes surround derrière nous (arrière gauche, arrière droite). On les note respectivement comme ça : L C R sL sR
L'écoute au casque Binaural permet d'émuler un système multicanal. Avant de poursuivre la lecture de cette rubrique brancher votre casque audio pour profiter d'une expérience sonore idéal.
Prenons un exemple de scène,
À l’image :
Plan large, fixe, jour, dans un jardin public, au centre de l’image un personnage assis sur un banc nourrit des oiseaux.
Au son :
Le bruit des oiseaux, le bruit de la ville, le bruit d’enfants qui jouent hors-champs. Voilà ce que le metteur en scène et le réalisateur veulent laisser entendre aux spectateurs dans cette scène.
On peut déjà différencier deux catégories de sons : ceux que l’on voit à l’image (le bruit des oiseaux) et ceux que l’on entend hors de l’image (le bruit de la ville, le bruit des enfants).
Dans le mix on peut alors disposer nos trois sons :
source C : le bruit des oiseaux
source L R et sL sR : le bruit de la ville
source sL sR : le bruits des enfants qui jouent
NOTE :
Ce schéma de mix n’est pas une règle absolue, mais une manière d’expliquer le rôle d’une spatialisation. Les seules règles sont celles qu’on se donne, mais l’essentiel est de garder tout au long d’une œuvre une cohérence dans ses choix. L’objectif d’un mixage est de ne jamais le laisser entendre à l’auditeur, il ne faut jamais laisser apparaître aux oreilles les enceintes de la salle, les sons doivent former un ensemble, reformer un environnement.
Pour la spatialisation des dialogues d’une scène, voir Traitement des dialogues.
3. Atmosphère, le dernier plan sonore :
Atmosphère, c’est le nom donné au bruit le plus éloigné dans le mix. Ce bruit a pour rôle de lier tous les autres, de créer une sensation de profondeur dans une image.
Quand on dessine sur une feuille blanche un personnage, un arbre et une maison, le dessin est compréhensible. Mais si on trace une ligne horizontale qui passe derrière ces trois éléments, on crée alors une profondeur, un horizon, et le dessin nous apparait alors plus réaliste. Le bruit Atmosphère c’est cette ligne d’horizon, il nous donne ce repère dans l’espace d’une scène.
Entendre l’Atmosphère,
voici deux exemples audio, le premier contient uniquement les bruitages de premiers plans, dans le deuxième on a ajouté le bruit atmosphère et ça change tout.
Extrait du court-métrage « Face à face » disponible ici
Ecouter nos Atmosphères uniques captées sur le terrain : Soundpaks.
4. Plus loin dans le mix, « Faire evoluer un son » :
Reprenons notre scène,
À l’image :
Au premier plan, entre dans le champ un cycliste sur son vélo, de la droite vers la gauche, à son passage des oiseaux s’envolent.
Au son :
Le bruit d’un vélo roulant sur un sol en gravier, le bruit d’oiseaux qui s’envolent.
Dans le mix on peut alors disposer nos deux sons :
Bruit du vélo : évolution du son de R à C à L
Bruit des oiseaux : évolution de C à L R
NOTE :
Les évolutions des sons dans les sources sonores peuvent être des choix artistiques mais dans notre cas, puisque le vélo apparait de droite à gauche, il aurait été difficile d’assumer le choix de faire évoluer le bruit du vélo de L à C à R.
On peut aussi noter que plus on a d’enceintes autour de nous plus on a de possibilités d’évolutions. Un système 7.1 permet plus de précision que dans un système 5.1, par exemple.
La technologie Atmos (7.1.4) est la dernière innovation dans les salles de cinémas. En plus des sources qui diffusent les sons à l’horizontal, comme dans les autres systèmes, on ajoute des sources verticales qui proviennent du plafond (c’est le .4 dans le 7.1.4). Grâce à cette technologie on peut désormais travailler dans la troisième dimension sonore. Autrement dit, beaucoup plus de choix créatif, donc plus d’immersion pour le spectateur.
5. Encore plus loin dans le mix, « Un effet de réalisme » :
Reprenons notre scène,
À l’image :
Le personnage assis sur le banc tourne brusquement la tête sur sa gauche, attiré par le bruit d’un klaxon de voiture.
Au son :
Bruit d’un klaxon de voiture.
À l’image, on comprend que le son semble venir de la droite hors-champ, on peut alors disposer notre son sur le canal de droite, R.
Mais si dans cette situation, on envoyait aussi notre son de klaxon à l’opposé de là où il semble provenir ? En ajoutant une réverbération bien dosée, on laisserait entendre aux spectateurs une sorte d’écho du klaxon venir de son arrière gauche (sL).
Puisque que l’oreille sait naturellement que les échos sont des sons opposés à leurs sources réelles, l’illusion pour le cerveau du spectateur est faite.
Dans le mix on peut alors disposer notre nouveau son :
Source sL : bruit écho du klaxon (plus ou moins fort)
Source R ou sR : bruit sec du klaxon (plus ou moins fort)
NOTE :
Cet effet ne peut pas convenir pour tous les bruits, tout dépend du son que l’on entend. Ici notre cas fonctionne à l’image, car en ville au milieu des immeubles il est courant d’entendre l’écho qui accompagne le klaxon frapper les parois des bâtiments.
On retrouve aussi cette sensation quand on entend passer dans le ciel le son d’un avion, on essaye d’abord de le repérer de là où il nous semble provenir alors que bien souvent il se situe à son opposé.
Aurions-nous fait la même chose si à la place du klaxon d’une voiture on avait choisi une sonnette de vélo ? À noter que si l’on ne sait pas comment réagit un son dans un environnement, on peut le reproduire en situation réelle et écouter ses réactions acoustiques.
6. L’enceinte basse (LFE)
La plupart du temps il ne s’y passe pas grand-chose, pas de dialogues, pas de musiques, pas de bruitages. Au cinéma, il ne faut pas considérer cette enceinte comme une basse de salon, mais plutôt comme un subwoofer vraiment très bas (< 80Hz). Les fréquences basses sont déjà dans les enceintes principales, ce sub est là pour créer les vibrations basses que l’on sent passer à travers notre corps.
Par exemple, des impacts, des explosions, des chocs sont des sons bas qui arrivent à nos oreilles depuis les enceintes principales, mais si on ajoute l’infrabasse de ses sons dans le LFE, les sensations d’impacts, d’explosions ou de chocs seront plus percussifs et plus physiques.
Contre-exemple : Le Hobbit, la désolation de smaug. Dans la scène du dialogue entre Bilbon et le dragon Smaug, la voix du hobbit se diffuse dans la source C alors que la voix du dragon se trouve dans toutes les sources, y compris dans l’enceinte LFE. Une voix dans le sub ? C’est ici un choix artistique et à mon sens totalement justifié.
Pour finir :
Quand on regarde un film au cinéma, écouter les sons et essayer de distinguer les enceintes de la salle ou de ressentir la physique des enceintes basses (LFE) est un bon exercice pour comprendre les choix artistiques des mixeurs.

Valentin LAVOILLOTTE
Fondateur du studio
Rédigé le 8 juillet 2023